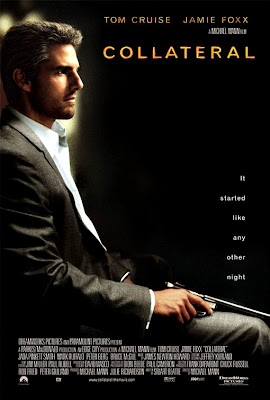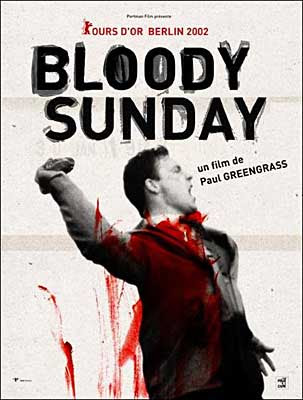Thème classique, l’amnésique à la recherche de son identité. Mais quand il y a une bonne histoire, quand chaque scène fait progresser le récit, quand chaque bagarre, fusillade,
course-poursuite ont un sens, ça peut être passionnant. La quête est à la fois
jubilatoire et effrayante, ce que
Matt Damon arrive à faire ressentir à merveille. Il est étranger à lui-même. Ce qui le rend si proche. C’est un film d’action fascinant.
Pour faire croire que la suite n’est pas qu'une initiative commerciale, un réalisateur auréolé d’une réussite dans la fiction documentaire a été embauché ;
Matt Damon a déclaré
qu’il n’y participerait
qu’à la condition que le scénario soit bon ; la promotion a insisté sur le fait
qu’il s’agissait de l’adaptation de la suite du livre, et non pas de la suite du film ; on a engagé les mêmes acteurs, plus
Joan Allen et un des guerriers farouches du Seigneur des Anneaux (
Karl Urban, inexpressif). Peine perdue ! C’est un navet, inintéressant de bout en bout, parce
qu’il est décalqué sur le premier film, et donc sans aucun intérêt, puisque tout est déjà dévoilé. Avec beaucoup de cascades, fusillades et péripéties qui ne mènent à rien. Le plus drôle étant
Joan Allen. Elle a dû recevoir la consigne d’imiter
Chris Cooper, le méchant du premier film. Elle le fait bien. C’est ridicule. La production a même recasé un second rôle (
Julia Stiles) dans une tentative grotesque pour recréer l’équipe.
Matt Damon interprète son personnage comme dans le premier film, ce qui n’a aucun sens. J’espère
qu’il a gagné beaucoup d’argent car je l’aime bien.
Le
réalisate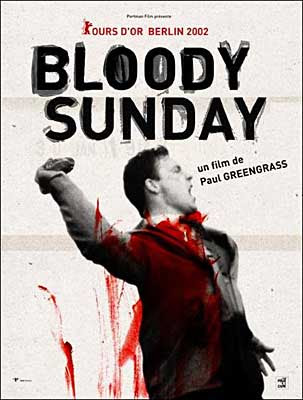 ur
ur, Paul
Greengrass, est l’auteur d’un film réquisitoire contre l’armée britannique, coupable du massacre d’innocents participants à une marche pacifiste en
Irlande du Nord. Les faits sont terribles, et la démonstration semble implacable, filmée comme un documentaire, c’est à dire comme si un
caméraman avait été présent pour filmer toutes les scènes du film. Donc l’image tremble, le cadrage est imposé par l’action, caméra à l’épaule, son d’ambiance. Mais on se rend vite compte
qu’il s’agit d’un truc de mise en scène, parce
qu’il ne peut pas y avoir de
caméraman présent pour filmer certains plans. Le procédé se retourne contre lui-même
puisqu’il apparaît comme une tricherie. Une tentative pour masquer la subjectivité du propos qui finalement attire l’attention sur la reconstitution partiale et finit par
desservir le film. Le propos est peut-être admirable, les acteurs sont exceptionnels, mais n’aurait-il finalement mieux pas fallu traiter cette histoire de manière plus distanciée, sans point de vue clairement identifiable ?
Quand Paul
Greengrass réalise La mort dans la peau, il conserve partiellement les trucs qui ont fait le succès de
Bloody Sunday, et on se rend bien compte
qu’il s’agit d’un artifice de mise en scène destiné à plonger dans l’action. Et le spectateur sait
qu’il n’y a pas, dans l’histoire, de
cameraman assit à l’arrière de la voiture pilotée par
Matt Damon. L’image tremblante, le cadrage décalé, privilégient le fond (l’histoire) par rapport à la forme (l’esthétique). Mais ce sont surtout des manières de ne pas choisir, et finalement de ne pas mettre en scène.
D’ailleurs,
Greengrass calme le jeu pour filmer La vengeance dans la peau – sans doute parce
qu’il n’y a plus de fond du tout. Sans enjeu réel, cet ultime épisode suit
Jason Bourne aux quatre coins du monde, dans des péripéties frénétiques qui démontrent à nouveau son extrême qualification – mais à quoi bon ? C’est assez haletant,
Matt Damon fait son numéro habituel, mais in fine ces
courses-poursuites ne mènent pas loin. On connaît son vrai nom. Super.